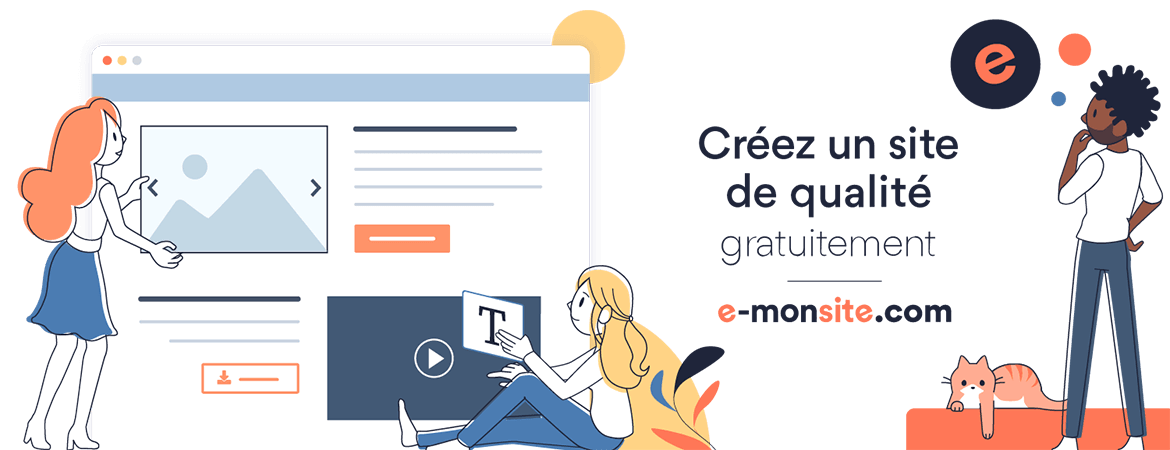Raphaëlle
I. Septembre
La terre est la matière première dont je suis faite. C’est par elle que tout commence, c’est par elle que mon histoire prend vie et forme.
Les mains et les pieds dans la boue. La bouche pleine de terre, il y a des vers sous ma langue, des fourmis sur mes yeux, des araignées dans mes cheveux. C’est tout un monde qui bruit de milles pattes et d’antennes, de corps mous ou exo-squelettiques. La terre. La boue. Cette matière grasse sous mes doigts, sous mes ongles, entre mes orteils, dans mon nombril, dans les plis de mon cou, sur toute ma peau, je la sens s’effriter. Si chaude et si réconfortante, la terre. Si opaque, si sombre et si malléable, la matière. Je pourrais m’y enfoncer, m’y enfouir, m’y ensevelir, m’y enterrer vivante car c’est ce que mon corps désire. Il ne désire pas l’étoile dont on l’a séparé, non, il désire la terre dont il est fait et ses odeurs si riches. Il veut se griser de ces senteurs de musc, d’humus, de feuilles, de mousse, de troncs en décomposition, de carcasses pourries, de germes de champignons et de moisissure. La terre. Les pieds, les mains et le visage dans la terre. Là je suis née, là je mourrai. Mon tombeau, mon berceau, la grise terre. Et la boue si gluante, si pâteuse et si élastique, comme elle obstrue mes narines et se colle à mes paupières ! Cette fange dans laquelle se roulent avec plaisir les bêtes sauvages et qui est tant dépréciée par les hommes. Comme ils ont tort ! Il n’y a rien d’aussi réconfortant que de sentir son corps se décomposer à même le sol. Trier le pur de l’impur. Dégrossir, décomposer, laisser toutes ses scories se mêler à cette pâte épaisse et ignoble qui macule mon corps. L’œuvre au noir commence dans la terre. Il y a des vers dans ma bouche et sous ma langue ; je les sens remuer leurs corps lisses et gluants, se heurter aux parois de mes joues et chatouiller la langue au point de me donner envie de vomir. Il y en a un qui s’est aventuré trop loin vers ma glotte, je pourrai l’avaler.
- Raphaëlle, relève-toi ! Immédiatement ! Qu’est-ce que tu fais par terre ? Tu es dégoûtante, tu me fais honte, tu n’as pas plus de retenue qu’un animal ! Même le cochon qui se roule dans la fange est plus propre que toi ! Relève-toi, sale truie !
Ainsi vitupère ma tante Séraphie en me donnant des coups de pieds pour que je me relève. Elle n’osera pas me prendre par la main pour m’aider à me sortir de là. Je suis trop sale pour elle. Je suis nue dans la boue. Je me redresse lentement, à regret, car il faisait chaud sous mon ventre. Je crache les vers qu’il y avait dans ma bouche aux pieds de ma tante.
- Tu es une fille dégoûtante et folle !
Elle me gifle. Elle a de la force, tante Séraphie. Ses bras de vieille fille n’ont rien perdu de leur vigueur. Ses cheveux gris sont tirés en arrière et elle me fusille de ses yeux porcins. Elle est en colère mais elle a peur de moi, je le vois bien. Ma joue me lance et me brûle. Je n’ai même pas envie de pleurer. On ne pleure pas devant les imbéciles.
- Rentre te laver et t’habiller immédiatement. Tout le monde t’attend pour dîner.
- Tout le monde, c’est toi, ton frère imbécile et la vieille chatte obèse, il n’y a pas pire compagnie que vous !
Je crache le dernier vers, coincé entre ma gencive et ma joue, à son visage. Je m’enfuis en courant vers la maison. Derrière moi, je l’entends qui hurle de rage. Je passe sous la barrière, quelques barbelés m’écorchent la peau du dos. Ça saigne rouge sur ma peau maculée de boue. Je cours pieds nus dans le verger. Il est magnifique en cette saison. Les poiriers croulent sous les fruits verts et ambrés ; les pommiers supplient qu’on dérobe leurs filles à la peau si rouge et si affriolante. Les odeurs accumulées dans la journée ressortent, capiteuses et entêtantes, en cette fin d’après-midi où le soleil tardif les flatte et les réchauffe de ses rayons dorés.
Je rentre par la porte de derrière, je salis le carrelage de mes pieds poisseux. Une araignée descend de ma jambe en vitesse. Au fond du couloir ma chambre, mon laboratoire, ma bibliothèque, ma cachette. La clé à mon cou ; la clé dans la serrure ; la porte ouverte puis refermée. Moi sous la douche ; l’eau qui lave la boue ; l’eau noire et marron qui coule à mes pieds. Les fourmis s’y débattent, s’étouffent, s’agitent et s’y noient, aspirées par le siphon. Trop d’eau sur tout mon corps. J’ouvre la bouche et je vomis toute la terre que j’ai avalée cette après-midi. Par paquets noirâtres, par régurgitations bileuses, tout tremble, s’agite et s’évacue. Je suis un volcan qui crache de la terre sous l’eau. Je n’ai plus rien dans le ventre, plus rien sous la langue. Je n’ai plus de forme. L’œuvre au noir. Je suis vidée. Décomposée comme l’humus. Goût de sel et de soufre dans la bouche.
Date de dernière mise à jour : 15/12/2020
Commentaires
-

- 1. Nathalie Le 08/02/2021
Belle transposition de l'oeuvre alchimique.
Ajouter un commentaire